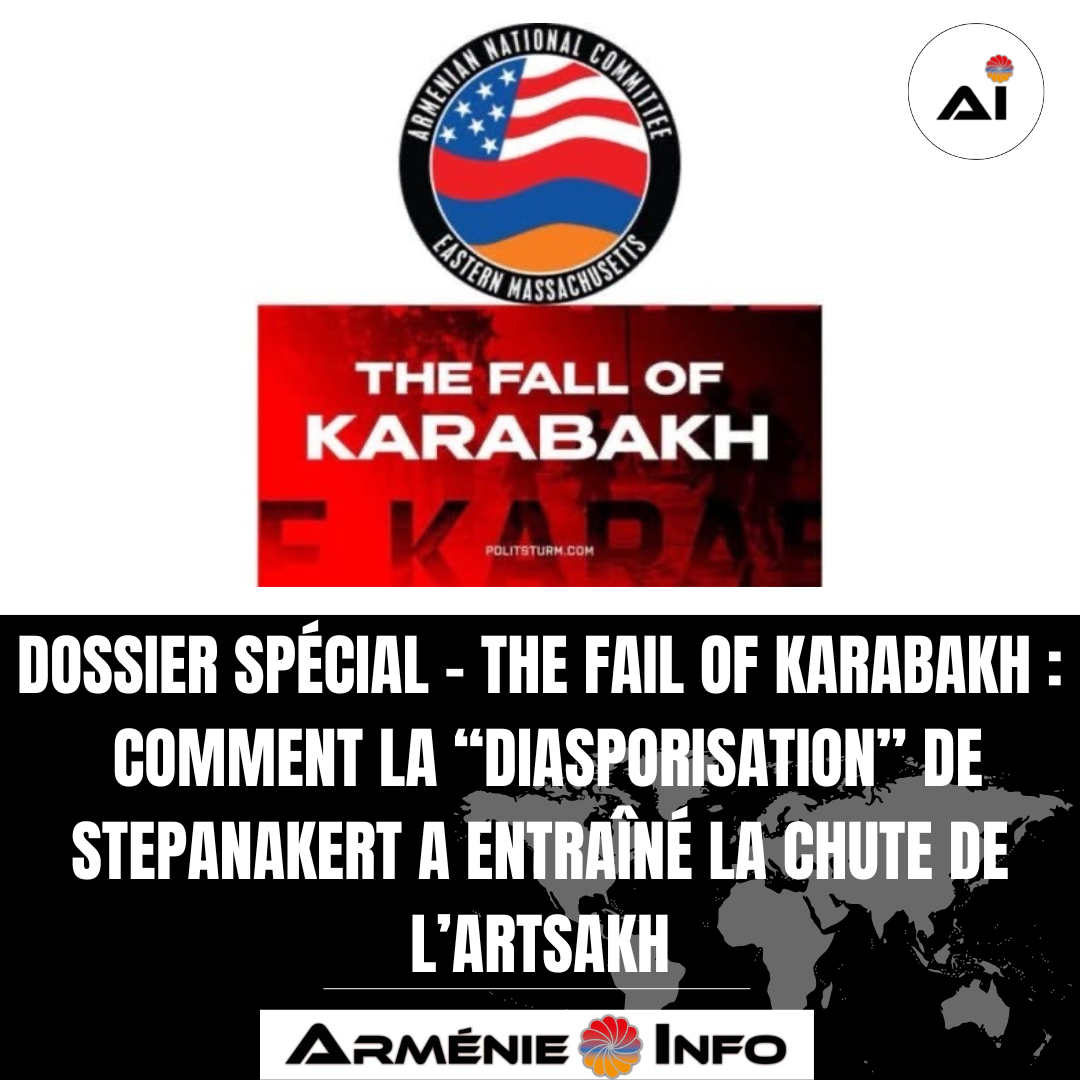Introduction
Découvrez le dossier spécial « The Fail of Karabakh » : comment la diasporisation de Stepanakert a entraîné la chute de l’Artsakh, avec les révélations de Vahram Atanesyan, ex-député du Parlement d’Artsakh.
Entre 2021 et 2023, l’Artsakh a été le théâtre d’un processus inédit : une implication croissante de la diaspora dans la gouvernance politique de Stepanakert, jusqu’à en devenir un moteur central. Cette « diasporisation », conçue comme un outil de survie et de résistance, s’est progressivement transformée en un piège, nourrissant fractures internes, isolement diplomatique et effondrement institutionnel.
⸻

Partie I — L’ouverture du bureau Hay Tad à Stepanakert
L’ouverture du bureau de la Cause arménienne (Hay Tad) de la FRA-Dachnaktsoutioun à Stepanakert, en 2021, fut un signal fort.
Les anciens présidents de l’Artsakh y assistèrent, mais non le président en exercice Araïk Haroutiounian. La seule représentation officielle fut assurée par le ministre des Affaires étrangères.
Les discours soulignèrent la nécessité de maintenir la subjectivité internationale de l’Artsakh et d’inscrire la capitale dans une logique de reconnaissance mondiale, malgré la défaite militaire de 2020 et la présence de forces russes.
Le message implicite était clair : la diaspora refusait la résignation et entendait jouer un rôle direct dans le destin de Stepanakert.
⸻

Partie II — Lobbying international et contradictions
La diaspora arménienne, et particulièrement la FRA via Mourad Papazian, intensifia ses efforts de lobbying auprès des institutions européennes et françaises.
La nomination de Georgi Petrosyan à la tête du bureau de Stepanakert visait à donner une légitimité historique à cette initiative.
La visite de Valérie Pécresse à Stepanakert, en décembre 2021, constitua un signal politique fort : bien qu’officiellement privée, elle suscita l’ire de Bakou et provoqua des tensions avec Moscou, qui observait d’un mauvais œil toute ouverture occidentale.
Mais cette stratégie se heurta à ses limites :
• d’un côté, elle permettait de maintenir la question du Karabakh à l’agenda international,
• de l’autre, elle ne débouchait sur aucune contrainte exécutive pour les gouvernements occidentaux.
La sécurité et le rapport de force restaient aux mains de la Russie et de l’Azerbaïdjan.
⸻

Partie III — 18 février 2022 : rejet de l’accord du 9 novembre
Le 18 février 2022, l’Assemblée nationale de l’Artsakh adopta une loi déclarant que tous les territoires perdus étaient « temporairement occupés », y compris ceux cédés par l’accord tripartite du 9 novembre 2020.
Cette décision revenait à un rejet frontal de la légitimité de l’accord signé entre la Russie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie.
Elle consacra une dualité du pouvoir à Stepanakert :
• d’un côté, le Parlement adopta une ligne dure et intransigeante,
• de l’autre, le président Haroutiounian, marginalisé, apparaissait de plus en plus isolé et accusé de compromission.

Partie IV — Avril à décembre 2022 : radicalisation et verrouillage
Le 14 avril 2022, le Parlement d’Artsakh rejette une proposition de Nikol Pachinian visant à « abaisser le seuil » des négociations pour obtenir un compromis international. La déclaration est sans équivoque :
« L’Artsakh ne sera jamais partie de l’Azerbaïdjan indépendant. »
Les députés refusent de reconnaître à Pachinian le droit de discuter avec Bakou du statut du Karabakh. À la place, ils appellent à une mobilisation nationale totale, avec un rôle accru pour la diaspora afin de renforcer le lobbying auprès de l’Europe et des États-Unis.
Mais ce choix intervient dans un contexte international très défavorable :
• La guerre en Ukraine a rompu la relation Russie-Occident.
• La Russie est isolée et plus méfiante que jamais vis-à-vis de toute tentative « pro-occidentale » à Stepanakert.
• L’OSCE Minsk est totalement paralysée.
L’épisode Hidalgo
Le 28 mai 2022, Araïk Haroutiounian rencontre Anne Hidalgo non pas à Stepanakert, mais à Goris, signe que les forces russes ont interdit son passage par le corridor de Latchine.
Cette rencontre, organisée avec l’appui de la FRA, provoque des réactions contrastées :
• Bakou y voit une provocation.
• Moscou y lit une ingérence occidentale.
• Sur le plan pratique, elle n’apporte aucun gain concret pour l’Artsakh.
Le verrouillage
Après un séjour de Haroutiounian en France en décembre 2022, Bakou bloque définitivement la route Goris–Stepanakert, tandis que les forces russes retirent leur poste de contrôle à Shushi-Karin Tak.
La capitale est désormais totalement dépendante du bon vouloir de l’Azerbaïdjan.
La circulaire 004 de la FRA
La circulaire 004 de la FRA (7 avril 2022) est appliquée à la lettre, aussi bien dans la diaspora qu’à Stepanakert. Le Bureau mondial de la FRA multiplie les initiatives :
• tentative d’imposer un président du Parlement issu de ses rangs,
• discours de plus en plus radicaux,
• rejet de tout compromis.
Ces choix ont des conséquences catastrophiques :
• perte du rôle d’arbitre de Moscou,
• fragilisation du pouvoir local,
• accélération du verrouillage par Bakou.
⸻
Partie V — Crise interne de la FRA et dérives stratégiques
Le Bureau mondial de la FRA est accusé de démarches aventuristes et irresponsables :
• mépris des réalités régionales,
• pari sur des soutiens occidentaux inexistants,
• isolement croissant d’Artsakh.
Même au sein de la FRA, les critiques se multiplient.
La 34ᵉ Assemblée générale mondiale est jugée un échec par Hrant Markarian.
À l’approche de la 35ᵉ (mars 2025), une question cruciale se pose :
• La FRA assumera-t-elle ses responsabilités dans l’effondrement de l’Artsakh ?
• Ou persistera-t-elle dans une ligne de confrontation vouée à l’impasse ?
⸻

Partie VI — L’arrivée de David Ishkhanyan et la gouvernance de l’ombre
Après la mise à l’écart d’Arthur Tovmasyan, David Ishkhanyan (FRA) devient président de l’Assemblée nationale.
Il parle de « gouvernance consensuelle », mais la réalité est différente :
• Les grandes décisions d’État passent désormais parlement et FRA.
• La Présidence est marginalisée.
• Le Parlement impose une ligne dure, sous l’influence directe de la diaspora.
Conflits internes
Les tensions s’exacerbent avec Samvel Babayan et son parti « Patrie Unie ».
Bien que co-signataire de la déclaration d’avril 2022, Babayan est accusé d’être une « force destructrice ».
Le climat est à la confrontation permanente.
⸻

Partie VII — Été 2023 : la crise des routes et la chute d’Araïk Haroutiounian
L’étau du blocus se resserre.
• Les convois humanitaires stationnent à Kornidzor, bloqués.
• L’Azerbaïdjan orchestre une opération de communication : deux camions de farine envoyés via Aghdam.
• À Askeran, des activistes du Front de Résistance et de Développement bloquent ces camions en dressant des pavés sur la route.
Face à la crise, Araïk Haroutiounian plaide pour une ouverture des routes : Goris–Stepanakert et Aghdam–Stepanakert.
Sa déclaration provoque un tollé : elle est perçue comme une capitulation.
Le lendemain, des responsables sont envoyés pour lever les pavés, mais la page du Front publie aussitôt un communiqué dénonçant tout compromis sur Aghdam, tout en avouant qu’ils n’ont pas pu refuser la mission du président.
Sous la pression des forces patriotiques et de l’opinion, Haroutiounian démissionne.
Les discussions sur l’ouverture des routes sont suspendues.
Neuf jours plus tard, Samvel Shahramanyan est élu président.
Vingt jours après son élection, il signe le décret de dissolution de la République d’Artsakh.
⸻

Partie VIII — 19–20 septembre 2023 : offensive azérie et capitulation
Le 19 septembre 2023, l’Azerbaïdjan lance une offensive militaire éclair.
• Stepanakert est bombardée.
• Les défenses arméniennes s’effondrent en 24 heures.
Le 20 septembre, le président Samvel Shahramanyan signe l’acte de capitulation :
• retrait de toutes les unités arméniennes,
• acceptation de la mainmise totale de Bakou.
Le même jour, le député Davit Melkumyan se rend à Yevlakh pour négocier et accepte toutes les conditions imposées.
L’exode
Dès le 25 septembre, commence l’exode massif :
• Martakert est vidée,
• Stepanakert suit,
• en quelques jours, toute la population arménienne du Haut-Karabakh quitte ses terres.
⸻

Partie IX — Les zones d’ombre et la disparition
Selon les révélations de Vahram Atanesyan :
• Armement : l’arsenal de l’Armée de défense est abandonné aux Russes, perçus comme agissant sous contrôle azerbaïdjanais.
• Archives : les archives d’État commencent à être détruites dès les 24–28 septembre.
• Transferts :
• des biens commerciaux auraient été déplacés vers Goris,
• des actifs financiers (liquidités, bijoux, gages bancaires) transférés à Erevan, sans certitude qu’ils aient été restitués,
• des véhicules publics récupérés par d’anciens responsables.
• Hypothèse non aboutie : maintenir 15 000 à 20 000 Arméniens à Stepanakert/Martouni pour prolonger la présence russe. Ce projet n’a jamais vu le jour.
Dissolution
Le 28 septembre 2023, le Bureau d’information d’Artsakh annonce officiellement que Shahramanyan a signé le décret de dissolution.
Contrairement au précédent de 1921 (le Comité de Salut de l’Arménie qui avait rendu des comptes et transféré une administration à Goris), aucun bilan officiel n’est publié sur les ressources perdues, détruites ou transférées.
⸻
Conclusion générale
La diasporisation de Stepanakert fut à la fois une tentative de résistance et une cause de dérive.
• Elle a permis de maintenir la cause arménienne vivante sur la scène internationale.
• Mais elle a aussi fragmenté le pouvoir, marginalisé la présidence, braqué Moscou, et donné à Bakou l’occasion d’imposer son verrouillage.
L’Artsakh a cessé d’exister non pas seulement sous le poids des armes, mais aussi en raison de ses propres fractures internes et des illusions portées par une diaspora trop éloignée des réalités du terrain.
Les révélations de Vahram Atanesyan soulignent les responsabilités : élites locales, FRA, diaspora, Erevan, mais aussi Moscou.
La chute de l’Artsakh n’est pas seulement une tragédie militaire ; c’est une tragédie politique et morale, où la mémoire de trois décennies de lutte s’est dissoute dans un mélange d’aventurisme, d’isolement et de compromissions.